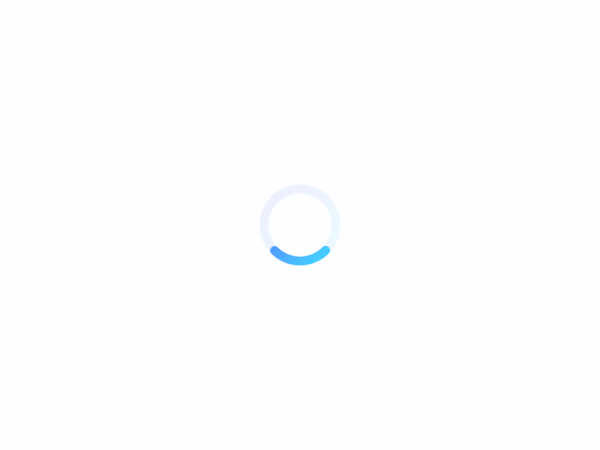Réalisées à l’occasion de la construction d’un immeuble et d’un parking souterrain à la rue des Jordils 25 à Yverdon-les-Bains, les investigations ont mis au jour des traces d’occupation datant de La Tène, un habitat de l’époque romaine, ainsi qu’un tronçon de la voie menant au centre du vicus d’Eburodunum, dont le tracé n’avait pas encore été précisément positionné. C’est la première fois que ce type de vestiges est documenté de manière aussi complète dans le quartier occidental de l’ancienne agglomération romaine.
Les premières traces de fréquentation du site, datées par de rares éléments de mobilier et quelques analyses au radiocarbones remontent à La Tène finale. Il s’agit d’un large empierrement linéaire, suivant une orientation nord-ouest / sud-est, mis en place dans le lit d’un ancien chenal peu profond. Il est délimité au nord par un mur de soutènement fait de pierres sèches, sans ossature de bois. Les rares trous de poteaux et autres traces de labours repérées dans une coupe stratigraphique témoignent d’une occupation liée à la circulation et peut-être à des activités agro-pastorales, dans un secteur qui reste tributaire, à ce moment-là, des transgressions du lac.
Dès l’époque augustéenne (vers 15/10 av. J.-C.) apparaît un quartier d’habitat sans doute en même temps qu’un premier niveau de voirie en galets. Il se matérialise par un bâtiment fondé sur des solins non maçonnés. Les sols sont en terre battue ou en plancher de bois. Le seul aménagement interne au bâtiment est un foyer constitué d’une sole en argile posée sur un lit de galets. À l’arrière du bâtiment, au nord de la parcelle, quelques fosses et des trous de poteaux occupent un espace d’arrière-cour. L’amorce d’un second bâtiment se dessine à l’est, mais il se développe presque entièrement en dehors de l’emprise de la fouille.
Après la destruction des premiers bâtiments, probablement par un incendie, d’autres sont reconstruits au milieu du 1er siècle ap. J.-C. Toujours érigés à l’aide de matériaux légers (fondations sur poteaux plantés et sablières basses sur solin de pierres sèches (fig. 1), ils reprennent les mêmes limites que les précédents. Ce nouvel état d’occupation est marqué par l’extension de l’habitat sur presque toute la parcelle. Plusieurs foyers et un cellier suggèrent une fonction domestique.
La tombe en inhumation d’un jeune enfant a été mise au jour dans cet habitat, à proximité immédiate d’un seuil. L’étude taphonomique indique que le jeune défunt était un périnatal inhumé en espace vide (fig. 2).
Durant cette même période, la voie est réaménagée avec des galets de plus gros module. Très bien conservée, elle possède alors une largeur d’au moins 7 m (fig. 3).
Des bases de portique ont été découvertes aux extrémités ouest et est de la fouille. Elles indiquent que l’habitat se prolonge en-dehors des limites de la parcelle, peut-être sous la forme d’une architecture maçonnée.
Une occupation moins dense a probablement perduré jusqu’au 3e s. voire au début du 4e siècle, se concentrant sans doute dans les bâtiments s’étendant hors emprise de la fouille. Les vestiges des couches supérieures du centre de la parcelle ont été fortement perturbés, notamment par la construction de la maison au 19e siècle. La voie a encore été utilisée au Bas-Empire pour rejoindre le castrum, comme l’atteste un fossé longeant ses derniers niveaux mal conservés et contenant du mobilier des 4e/5e s. Il est probablement à associer à un niveau de terres noires recouvrant les vestiges antiques, dont la chronologie et la nature exacte restent peu précises en l’absence de mobilier et d’études sédimentaires complémentaires.
Fouille Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, B. Oulevey.


 All chronicles
All chronicles