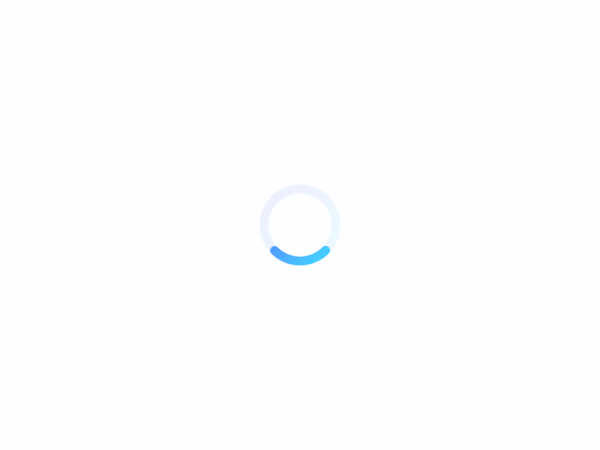Le projet d’extension de la laiterie de Belfaux a incité le Service archéologique de l’État de Fribourg à prescrire des sondages mécaniques, réalisés en automne 2023 dans l’emprise du futur bâtiment. Les indices d’une occupation enregistrés ont permis de circonscrire facilement la zone à investiguer dans le cadre d’une fouille préventive. En effet, contrairement à la densité notable des vestiges découverts sous la chaussée de la route du Centre en 2018, lors du remplacement des services souterrains, les structures apparues dans les surfaces sondées sont peu nombreuses. La mise au jour d’un parement en pierres sèches et d’une couche d’argile brûlée dans la parcelle où se situe la propriété témoigne d’une utilisation anthropique ancienne du lieu.
Sous les remblais de nivellement du jardin actuel, deux structures à moins d’un mètre de distance ont été documentées.
La plus ancienne est une fosse oblongue dite à pierres chauffantes de forme rectangulaire mesurant 257 x 80 cm. Elle est creusée dans le terrain naturel sableux, perpendiculaire à la pente. Elle est dotée d’un fond plat et de parois verticales surtout observées dans sa moitié nord. Le fond de la fosse est couvert au centre par un amas de brandons dont des échantillons ont été prélevés pour une datation 14C. L’ensemble était tapissé d’un lit de pierres rougies et fragmentées au feu, fissurées in situ. De plus, la rubéfaction du terrain encaissant, pourtant sableux, trahit les fortes températures qui ont émané de la structure. Les datations fournies par les analyses 14C démontrent une utilisation de la fosse entre 516 et 377 av. J.-C. Cette fourchette chronologique (Ua-84965, 2349±31BP, 516-377 BC, cal. 2 sigma) témoigne d’une continuité de cette pratique dans le canton de Fribourg dont les principaux exemples connus se situent à la fin de l’âge du Bronze final et à l’âge du Fer. L’usage unique du foyer est sans équivoque, mais l’absence de mobilier tait les motifs exacts de sa construction.
La deuxième structure de combustion, dont la partie haute a été démantelée, est un four rectangulaire de 250 x 315 cm (fig. 1). Partiellement enterrée et excavée dans l’axe de la pente, elle entame également les niveaux naturels. Trois côtés sont constitués d’un parement de galets tandis que le quatrième, plus épais, doté de deux parements, fait face à la pente et comprend la gueule du four (fig. 2). L’aire de chauffe attenante se développait sur 400 cm de largeur et sur 700 cm de longueur. À l’intérieur, seuls les vestiges de la chambre de chauffe sont conservés. Un prélèvement de charbon issu du foyer a permis de dater la phase d’utilisation de la structure entre 1393 et 1435 ap. J.-C. (Ua-84964, 541±29 BP, 1393-1435 AD, cal. 2 sigma).
Les traces de la dernière cuisson confirment l’usage de la structure pour la production de chaux. Par négatif, il est possible de distinguer l’emplacement de la charge à cuire de la zone réservée au foyer. Aucun autre matériau ou mobilier significatif n’est resté piégé ce qui limite les données interprétatives concernant les précédentes productions. La qualité sommaire de la construction confirme un usage temporaire.


 Alle Fundberichte
Alle Fundberichte