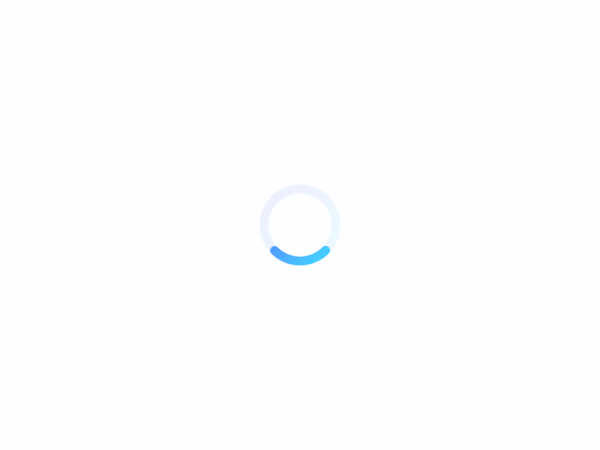Depuis octobre 2022, des fouilles archéologiques sont conduites dans le cadre des travaux de requalification du Bourg de Fribourg. L’année 2024 a été marquée par des interventions continues localisées sur le parvis de la cathédrale, rue des Épouses, rue du Pont-Suspendu et enfin sur la place Sainte-Catherine. Si les terrassements sont parfois peu profonds, le Service archéologique de l’État de Fribourg (SAEF) a aussi dû intervenir dans des tranchées et également lors de la creuse pour l’implantation de fosses d’arbre. Place Sainte-Catherine, le projet de création d’une nouvelle place agrémentée de quatre arbres a permis d’ouvrir une surface de 180 m2. Les structures rencontrées sont essentiellement funéraires et bâties. Elles concernent le cimetière qui s’est développé autour des églises (la première est consacrée en 1182) et qui recouvre une série de maisons médiévales, détruites lors de réaménagements du quartier. Le cimetière, déjà existant autour de la première église, s’agrandit avec la construction de la nouvelle église en 1283. Il sera utilisé jusqu’à son abandon en 1825.
Les tombes sont localisées depuis le parvis de la cathédrale jusqu’à la place Sainte-Catherine, à l’est. Sur cette dernière, les inhumations se trouvaient sur une surface qui s’étendait depuis le mur du chevet jusqu’à un puissant mur interprété comme la clôture du cimetière, soit son extension la plus orientale. Au sein de cet espace, une zone localisée au sud, présente une concentration importante d’immatures, parfois inhumés à plusieurs dans des fosses ou des cercueils dont seuls les clous subsistent. L’hypothèse d’un secteur réservé aux défunts non baptisés reste entière. Plus au nord, des adultes sont également inhumés, tête à l’ouest comme tous les défunts fouillés. La présence de plusieurs tombes multiples, dont l’une contenant 18 individus, suggère la survenue d’évènements tragiques tels que des épidémies. Vers le nord, le chevet pentagonal à contrefort de la chapelle Notre-Dame de la Compassion a été mis au jour. Édifiée dans le cimetière, les travaux de construction nécessitent la destruction d’inhumations existantes.
Lorsque les travaux ont nécessité des terrassements importants, il a été possible d’atteindre les structures des habitations urbaines, recouvertes par les différents niveaux de tombes. Les états de maison, documentés sur des surfaces restreintes à la rue du Pont-Suspendu, ont pu être investigués de manière plus extensive sur la place Sainte-Catherine, une fois les niveaux multiples de tombes dégagés. Plusieurs habitations dont l’organisation interne est modifiée à plusieurs reprises avant leur démolition sont construites de manière contiguës. Les niveaux de circulation associés aux rez-de-chaussée ont presque tous disparus lors des aménagements postérieurs notamment pour aménager des caves. Trois escaliers d’accès aux espaces souterrains sont conservés ainsi que des aménagements pariétaux tels qu’une niche murale dans la maison nord. Pour l’espace d’habitat reconnu au sud, l’escalier donnant accès à la cave est pratiqué dans les niveaux de circulation encore en place. La mise en relation de ces maçonneries avec celles découvertes rue du Pont-Suspendu permettra de compléter les plans de ces habitats, d’en mettre en évidence les choix constructifs et d’apporter une nouvelle vision de l’urbanisme au Moyen Âge à Fribourg.


 Toutes les chroniques
Toutes les chroniques