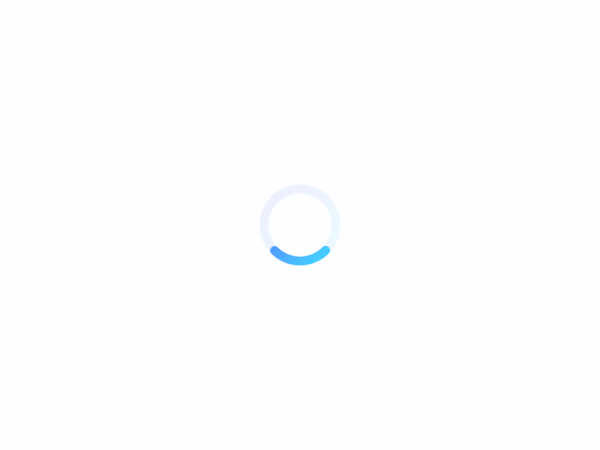En assurant annuellement le monitoring des stations littorales, l’office de l’archéologie cantonale de Neuchâtel (OARC) réalise en parallèle une importante documentation aérienne de la plateforme lacustre qui permet tout à la fois de suivre l’évolution des fronts d’érosion qui menacent les villages préhistoriques et d’anticiper les mesures à prendre pour leur protection. L’eau du lac de Neuchâtel devenant de plus en plus claire année après année, les images aériennes contribuent à la couverture photographique des hauts fonds jusqu’à une profondeur d’une dizaine de mètres, là où la dynamique d’érosion désensable régulièrement de nouveaux vestiges archéologiques.
En février 2024, lors de prospections réalisées en ballon dirigeable et à l’aide d’un drone, l’aérostier Fabien Droz a détecté deux nouvelles anomalies au large de la commune d’Hauterive, à une profondeur de 8 m. Des plongées de reconnaissance ont permis d’identifier deux embarcations très anciennes. Des analyses radiocarbone et dendrochronologique ont confirmé les observations visuelles en datant la première épave de la première moitié du 1er siècle av. J.-C. (C14 : ETH-1411977, 2050 ± 21 BP, 149 BC-21 AD, cal 2 sigma ; Dendro : 91 av. J.-C., terminus post quem) et la seconde du premier quart du 4e siècle apr. J.-C. (C14 : ETH-1411976, 1727 ± 20 BP, 251-405 AD, cal 2 sigma ; Dendro : 281 apr. J.-C., terminus post quem).
L’embarcation laténienne repose sur la craie lacustre et est en partie ensablée (fig. 1). Elle a fait l’objet d’une photogrammétrie complète et de relevés métriques de ses dimensions. Il s’agit d’un monoxyle en chêne (Quercus robur) évidé à la hache et à l’herminette en fer. Le tronc faisait 1.2 m de diamètre (sans l’écorce). L’esquif est cassé à l’emplacement de la poupe et la longueur conservée est de 7.7 m pour une largeur maximale de 1.1 m. Cette pirogue présente la particularité d’être munie de membrures destinées à renforcer la partie centrale. Elles sont fixées sur le monoxyle à l’aide de clous en fer, enfoncés de l’intérieur vers l’extérieur de l’embarcation. À l’échelle régionale, il s’agit de la plus ancienne attestation de membrures. Jusqu’à cette découverte, elles étaient uniquement connues sur les chalands gallo-romains du 2e siècle apr. J.-C., notamment sur ceux retrouvés dans le lac de Neuchâtel. Cette embarcation laténienne d’Hauterive constitue donc un chaînon important dans l’évolution de l’architecture des bateaux lacustres, entre la pirogue monoxyle préhistorique et le chaland romain réalisé à l’aide d’éléments assemblés.
L’épave datée de l’Antiquité tardive repose également à 8 m de profondeur (fig. 2). Lors de son naufrage, elle s’est posée sur le fond et s’est progressivement enfoncée dans la craie sous l’effet des courants du lac. La coque est en grande partie conservée, à l’exception de la planche supérieure du bordé. La poupe est prise dans le sédiment, alors que la proue émerge du sable. Une photogrammétrie de toute la zone a été réalisée, ainsi que des relevés métriques des éléments apparents. L’emploi d’une sonde à avalanche graduée – qui offre l’avantage de pénétrer profondément dans le sédiment sans abîmer d’éventuels éléments de cargaison – a permis d’effectuer différentes mesures et de documenter le profil transversal du bateau. Entièrement en chêne (Quercus sp.), cette épave mesure 17.4 m pour une largeur maximale de 5.1 m. La hauteur des parties conservées du flanc est de 1 m (mesure prise depuis l’intérieur de la sole jusqu’au sommet des membrures). Le plat bord n’est toutefois pas conservé et il faudrait ajouter son épaisseur pour avoir la hauteur réelle. La cohésion mécanique entre les éléments de la coque résulte en partie d’un clouage de liaison qui n’est pas aussi dense entre les éléments longitudinaux (bordés) et transversaux (membrures) que ce qui a été observé sur les chalands du 2e siècle. Des assemblages en bois doivent nécessairement venir compenser le faible nombre de liaison en métal. À l’avenir, des sondages permettront de documenter l’architecture complète de ce bateau, les types d’assemblage ainsi que les techniques d’étanchéité.


 Alle Fundberichte
Alle Fundberichte