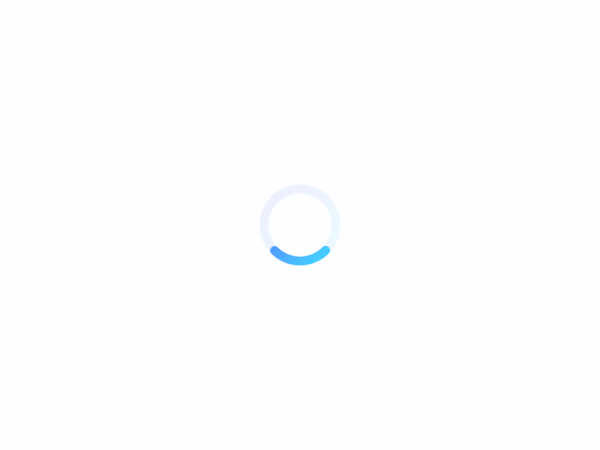En vue de documenter les fortifications apparentes du bourg castral d’Arconciel FR, Vers les Châteaux (11e s.), promises à consolidation, différents travaux préliminaires ont été menés depuis 2023 sur le site par le Service archéologique de l’État de Fribourg (SAEF), avec la collaboration de l’Université de Bourgogne (UMR 6298 ARTEHIS) et de l’association Arconciacum. En avril 2024, une semaine de terrain a été organisée pour documenter et établir le phasage des maçonneries, réaliser des prospections visuelles approfondies et au détecteur de métaux dans la moitié ouest de la colline ainsi qu’ouvrir plusieurs petits sondages dans l’optique de compléter le plan des lieux, de mieux caractériser les zones d’occupation et d’en affiner la chronologie. L’observation des élévations a essentiellement concerné les maçonneries visibles de la tour occidentale, objet de la consolidation des fondations (dont le suivi a été fait en septembre 2024), la tour orientale ainsi que la portion subsistante d’une courtine.
La structure initiale de la tour occidentale, mesurant 9 m de côté, comprend deux étages d’habitat et d’agrément. La baie géminée à linteau monolithe et colonnette, visible sur sa face ouest, permet une datation stylistique au début du 13e s. (fig. 1). Un incendie, dont le parement intérieur porte les marques (visibles sur la face sud-est), semble avoir eu raison de l’habitation (fig. 2). La phase suivante est marquée par l’obturation des ouvertures par des blocs de molasse rubéfiée. Trois petites bouches à feu sont alors créées au deuxième étage, encore en service. Enfin, une « tour intérieure » est élevée, condamnant toutes les ouvertures précédentes. Son sommet semble aménagé en plate-forme.
Les datations par dendrochronologie et 14C réalisées sur un charbon de bois prélevé dans le mortier de la maçonnerie intérieure situent cette phase de construction dans la seconde moitié du 14e s., soit peu avant l’abandon du site durant la première moitié du 15e s., selon les sources écrites. Ces premières datations doivent être confirmées par d’autres analyses.
L’analyse stylistique de la tour orientale ne permet pas de proposer une datation précise, mais la conservation de ses parements intérieurs atteste d’au moins deux phases marquées par des changements de niveaux (fig. 3).
Les sondages exploratoires ont permis de compléter la documentation de 1975 sur plusieurs espaces d’habitat. Différents tronçons de murs ont été géoréférencés et quelques structures inédites ont été repérées. Parmi elles, citons un nouveau bâtiment, qui semble avoir occupé une surface d’environ 15 x 8 m (espace plane aménagé), situé en aval du sentier forestier. Creusée dans la molasse, une niche avec des vestiges d’enduit peint rouge et blanc y a été identifiée. Les sondages ont mis au jour de nouveaux fragments de céramique, notamment des catelles de poêle. Ce mobilier s’ajoute aux objets découverts depuis 1975 sur le promontoire, portant ainsi le corpus à plus de 400 artefacts.
Les premiers résultats issus de l’analyse du mobilier, du phasage du bâti et de la caractérisation des espaces sont encourageants. La suite des opérations archéologiques s’intégrera dans le programme de restauration des tours porté par Arconciacum. Le site, pivot du projet de recherche sur la morphogénèse du Bourg castral en Suisse romande, verra la poursuite de la collaboration entre le SAEF et le laboratoire ARTEHIS.


 Tutte le cronache
Tutte le cronache