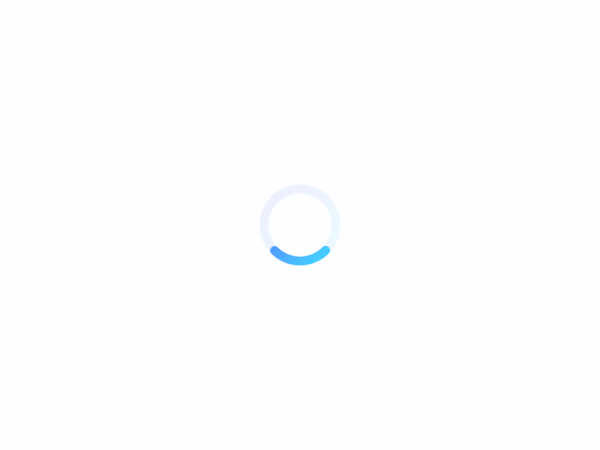Les fouilles menées depuis juin 2024 dans le cadre du projet «Métamorphose» de la Ville de Lausanne portent sur une surface d’environ 8 hectares, dans la partie occidentale du site de Lousonna-Vidy (fig. 1). Les travaux planifiés jusqu’en 2028 mobilisent une équipe de 25 personnes travaillant en continu aux opérations de fouille et de traitement du mobilier (fig. 2).
Pour le Mésolithique, la fouille de niveaux bien conservés sur une surface de plus de 150 m2 a livré près de 5800 artefacts lithiques, dont 1800 cotés et 4000 retrouvés au tamisage, témoignant d’une intense activité de débitage. La typo-chronologie des pièces et les premières datations 14C permettent de dater ce gisement à la transition entre le Mésolithique ancien et moyen, vers 8000 BC. L’occupation livre également deux structures foyères, de nombreux écofacts (3000 restes de faune, de coquilles de noisettes et de charbon), et la carte de répartition du mobilier présente des effets de concentration et des indications fonctionnelles qu’il conviendra d’affiner. L’extension du/des campement(s) se poursuit en direction du nord, de l’est et de l’ouest, alors que la limite sud paraît se préciser. Des niveaux de galets et le pendage naturel du terrain observés ponctuellement posent l’hypothèse d’une occupation de plage, alors qu’en partie méridionale du site, la présence de mobilier et de couches organiques datés du second Mésolithique ouvre une réflexion plus large sur l’occupation humaine des terrasses lémaniques après la dernière glaciation. Au sommet du gisement, un paléosol anthropisé dans lequel s’ouvrent une série de fosses et de trous de poteaux atteste une occupation de nature indéterminée, datée du Néolithique ou de l’âge du Bronze.
Pour l’époque romaine, l’ouverture d’une surface de 1600 m2 au sein de la nécropole permet d’évaluer l’organisation et l’évolution de l’espace funéraire, entre la fin du 1er s. av. et le 4e s. ap. J.-C. Du nord au sud, on perçoit une répartition des sépultures à inhumation et à crémation, avec une grande variété de dépôts et des indices de délimitation interne (fig. 3). La typologie des 600 fosses identifiées correspond à de rares structures de combustion, des dépôts de crémation avec ou sans vase ossuaire, des dépôts de résidus de crémation, de mobilier, des inhumations et des structures indéterminées. Plusieurs constructions quadrangulaires en pierre sont interprétées comme des enclos et une tombe à inhumation maçonnée se distingue par son aspect monumental. Parmi l’abondant mobilier exhumé, une inscription funéraire complète a été découverte en position secondaire (fig. 4).
Les abords de la nécropole fouillés en aire ouverte sur près de 10 000 m2 offrent une bonne vision du quartier funéraire. Au sud, une voie dégagée sur une centaine de mètres se poursuit en direction du sanctuaire périurbain découverte en 1985. La chaussée empierrée, large de 8 m, doublée de fossés bordiers au nord, traverse une zone humide caractérisée par des niveaux de tourbe et des dépôts lacustres. À l’est, un fossé d’orientation nord-sud marque potentiellement une limite entre la nécropole et l’espace cultuel, en lien avec des fosses à dépôts de céramiques et de restes d’équidés. Dans le même secteur, plusieurs grands creusements peuvent correspondre à des mares, des fosses d’extraction ou des dépotoirs.
La poursuite des investigations en direction de l’ouest permettra de mieux appréhender la partie centrale de la nécropole, l’espace suburbain et la continuité des occupations du Mésolithique.
Fouille: Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Guichon R., Deseine A., Thorimbert S., Millet M.


 Alle Fundberichte
Alle Fundberichte