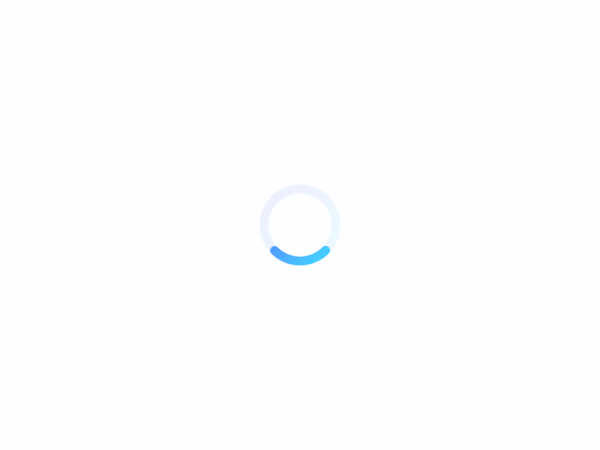Dans le cadre du projet de végétalisation de la cour du cloître de l’église Saint-Jean Baptiste, qui induisait la creuse de plusieurs fosses de grandes dimensions destinées à accueillir des arbres, l’Archéologie cantonale a demandé la réalisation de sondages diagnostiques pour vérifier la présence de structures sépulcrales, et, le cas échéant, envisager un changement de projet.
L’église Saint-Jean Baptiste est située au sommet de la colline occidentale du bourg médiéval de Grandson, implanté sur la rive ouest au sud du lac de Neuchâtel, le château occupant la colline orientale. Une première église et des bâtiments conventuels auraient été érigés entre 1146 et 1178, date à laquelle le prieuré est entré dans l’orbite de l’abbaye de La Chaise-Dieu.
La fouille de 2015-2016 avait mis au jour, dans la Rue Haute et les rues attenantes, de « 187 sépultures en position primaire et quelques 58 ensembles d’ossements, répartis entre réductions et lots de vrac » (Pradervand, Thorimbert, Pedrucci, et al., 2020), ainsi que des vestiges maçonnés correspondant à différentes phases de construction s’étalant du 12e – potentiellement – au 18e siècle dans la zone de l’entrée du cloître.
La cour est actuellement située environ 1-1.5 m plus bas que le niveau de la chaussée et délimitée à l’est, au sud et à l’ouest par des bâtiments (Rue Haute numéros 23 à 27). Outre la présence de sépultures, il convenait donc de vérifier si des structures maçonnées pouvant correspondre aux vestiges des anciennes arcades des ailes est et sud du préau du cloître, détruites probablement aux alentours de 1730, étaient présentes dans l’emprise des sondages.
Deux tranchées perpendiculaires, orientées nord-sud et ouest-est, ont été prévues de manière à se croiser au centre du cloître (fig. 1). L’intervention se limitant à une constatation succincte sans nettoyage des structures, il s’agissait essentiellement de documenter leurs positions après décapage, ainsi que d’en dresser une brève description et une identification si possible. La fenêtre ouverte étant restreinte, elle n’a pas permis d’observer les structures dans leur ensemble, l’identification reste donc limitée.
Ainsi, un total de quatre sépultures avérées, six sépultures probables et trois structures indéterminées ont été partiellement observées lors de l’intervention, à une faible profondeur de 0.22 m, presque directement sous le niveau de circulation actuel du cloître. Réparties sur l’ensemble de la surface des sondages, les orientations de trois des sépultures avérées ont été déduites ouest-est, tandis qu’un défunt est orienté tête au nord. Les trois structures indéterminées étaient situées à l’est du cloître. Il reste à noter que de nombreux ossements humains en position secondaire ont été observés dans l’emprise des tranchées.
L’intervention, bien que limitée, a confirmé la présence de structures sépulcrales au sud de l’édifice, enfouies plus profondément d’un mètre que celles précédemment fouillées devant l’entrée du cloître, mais à une altitude semblable à celles des sépultures mises au jour au début des années 2000 à l’intérieur de l’église. Les constatations menées sur le terrain n’ont pas mis en lumière de structures maçonnées relatives aux nombreux travaux de construction du cloître opérés entre les 12e et 19e siècles, hormis des structures indéterminées qui pourraient potentiellement y être rattachées.
Fouille: Archéotech SA, Épalinges, V. Remond.


 Tutte le cronache
Tutte le cronache